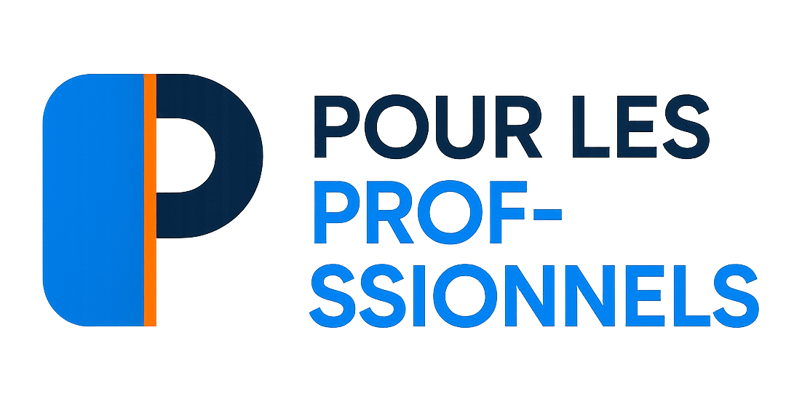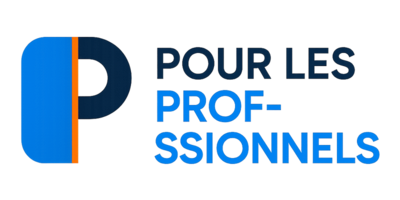Les chiffres ne mentent pas : depuis le 1er janvier 2020, le CHSCT a disparu du paysage social français, laissant place à une nouvelle organisation imposée à chaque entreprise ayant franchi le seuil d’effectif requis. Aucune option pour les employeurs ; la bascule vers le Comité social et économique s’est opérée sans détour, que la structure compte 15 ou 500 salariés.
Ce changement de nom n’efface pas pour autant les missions historiques du CHSCT. Prévention, santé, sécurité au travail : tout cela se poursuit, mais dans un cadre renouvelé, au sein du CSE ou à travers des commissions dédiées lorsque la taille de l’entreprise l’impose. Le terrain et les rôles ont été redéfinis en profondeur, bouleversant les repères traditionnels de la gestion des conditions de travail.
Pourquoi le CHSCT a disparu au profit du CSE : origines et enjeux de la réforme
Le nouveau nom du CHSCT n’est pas une simple affaire de vocabulaire. Derrière la suppression du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, on retrouve la volonté affichée par les ordonnances Macron de 2017 de remettre à plat la représentation du personnel. Trop d’instances, trop de doublons, trop de lenteur : le diagnostic était posé. Délégués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT cohabitaient, parfois sans efficacité, jusqu’à brouiller les circuits de décision et alourdir la machine administrative.
Le comité social et économique (CSE) remplace ces trois structures. Il devient l’unique organe de représentation dès 11 salariés, et dès 50, il élargit son spectre à tous les sujets : santé, sécurité, conditions de travail, mais aussi activités sociales et économiques. Plus de séparation, un seul point d’ancrage pour tous les sujets collectifs. La mise en place de ce nouveau comité bouleverse la logique d’origine : les représentants du personnel sont rassemblés, les rôles sont redéfinis, la négociation s’organise autrement.
| Avant la réforme | Après la réforme |
|---|---|
| CHSCT, comité d’entreprise, délégués du personnel | CSE unique avec commissions spécifiques selon l’effectif |
Les articles du code du travail et le décret relatif aux comités sociaux encadrent tout : composition, missions, moyens attribués aux élus. Ce basculement impacte la gouvernance interne des entreprises : informations centralisées, circuits de décisions raccourcis, interactions modifiées entre direction et salariés. Cette réforme, pensée pour gagner en efficacité, soulève aussi des interrogations : le CSE saura-t-il maintenir la vigilance sur la santé et la sécurité au travail, ou risquera-t-il de passer à côté de certains signaux ? Le débat reste ouvert dans de nombreux secteurs.
Quelles différences concrètes entre CHSCT, CSE et commission CSSCT ?
Impossible de confondre l’ancien paysage du dialogue social avec celui d’aujourd’hui. Le CHSCT occupait une place singulière, consacrée à la prévention des risques professionnels et à la santé, sécurité, travail. Désormais, cette responsabilité bascule intégralement dans le giron du comité social et économique (CSE).
Pour saisir les écarts, il faut s’attarder sur la façon dont les rôles sont désormais distribués :
- Le CHSCT fonctionnait comme une entité autonome, réunissant élus et employeur, tous spécialisés sur les enjeux d’hygiène, sécurité, travail.
- Le CSE regroupe tous les représentants du personnel, titulaires et suppléants, et l’employeur, pour traiter à la fois les questions de conditions de travail, les dossiers sociaux, économiques et la prévention des risques.
Un point de jonction a été créé : la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Obligatoire dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ou sur demande de l’inspection du travail, cette commission agit comme une émanation spécialisée du CSE. Elle n’a pas d’existence juridique à part entière : elle prépare les travaux, formule des propositions, mais c’est toujours le CSE qui tranche en dernier ressort.
La mise en place de la commission CSSCT reste conditionnée par l’effectif et le contexte. Les membres du CSE la composent, parfois épaulés par des salariés désignés pour leur expertise en santé et sécurité. Cette organisation favorise la transversalité, mais certains acteurs du dialogue social pointent le risque : la vigilance, autrefois concentrée, pourrait se disperser. La prévention des risques professionnels, désormais partagée, s’intègre dans une gouvernance plus large, où la coordination prend le pas sur la spécialisation pointue.
Ce que ce changement implique pour les salariés et les employeurs aujourd’hui
L’effacement du CHSCT, au profit d’un CSE omniprésent, redéfinit la répartition des rôles et des responsabilités, aussi bien pour les salariés que pour l’employeur. Désormais, un seul interlocuteur gère à la fois la santé, la sécurité, les conditions de travail ainsi que les aspects sociaux et économiques.
La prévention des risques professionnels traverse désormais tous les échanges. Les salariés savent à qui s’adresser pour signaler une difficulté, qu’il s’agisse d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’enjeux de santé mentale. La circulation de l’information se veut plus directe, mais l’exigence de vigilance demeure : la spécialisation du CHSCT garantissait un suivi rigoureux. Avec le CSE, il faut une organisation interne solide pour que la prévention reste une priorité et ne se dilue pas dans la masse.
Côté employeurs, la nouvelle structuration implique une gestion différente des obligations en matière de sécurité au travail. Les consultations obligatoires du CSE sur la prévention et la protection de la santé deviennent un passage obligé. Les représentants du personnel, qu’ils siègent au CSE ou à la CSSCT, doivent développer une vision renouvelée du dialogue social, capable de relier enjeux sanitaires, risques psychosociaux et thématiques économiques.
Dans les structures de plus de 300 salariés, la commission santé, sécurité et conditions de travail devient un relais précieux, sans pour autant faire renaître l’approche du CHSCT. Entre établissements publics et entreprises privées, le code du travail reste le guide, mais les interprétations évoluent : on recherche l’harmonisation, l’échange de compétences, la capacité à anticiper les risques collectifs.
Le changement de nom du CHSCT n’est pas qu’un détail administratif. Il marque un tournant, une nouvelle façon d’aborder la santé au travail, où la vigilance ne doit jamais baisser la garde. Le dialogue social, lui, n’a pas fini de se réinventer.